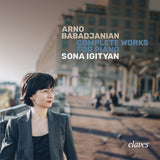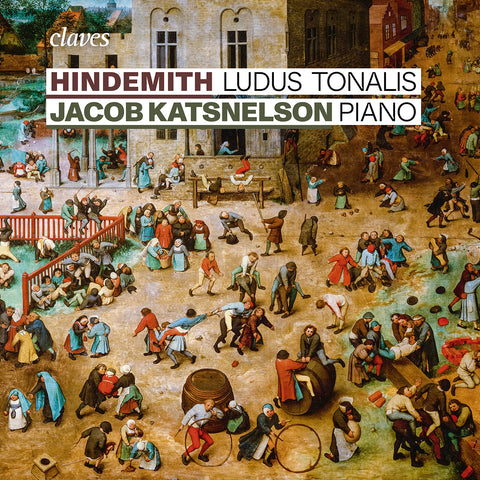(2025) Arno Babadjanian: Works for piano
Catégorie(s): Piano Raretés
Instrument(s): Piano
Compositeur principal: Arno Babadjanian
Nb CD(s): 1
N° de catalogue:
CD 3131
Sortie: 26.09.2025
EAN/UPC: 7619931313122
(L'album sera envoyé quelques jours avant la sortie officielle).
Cet album est en repressage. Précommandez-le dès maintenant à un prix spécial.
CHF 18.50
Cet album n'est plus disponible en CD.
Cet album n'est pas encore sorti. Précommandez-le dès maintenant.
CHF 18.50
Cet album n'est plus disponible en CD.
CHF 18.50
TVA incluse pour la Suisse et l'UE
Frais de port offerts
Cet album n'est plus disponible en CD.
TVA incluse pour la Suisse et l'UE
Frais de port offerts
Cet album est en repressage. Précommandez-le dès maintenant à un prix spécial.
CHF 18.50
Cet album n'est plus disponible en CD.
This album has not been released yet.
Pre-order it at a special price now.
CHF 18.50
Cet album n'est plus disponible en CD.
CHF 18.50
Cet album n'est plus disponible en CD.
ARNO BABADJANIAN: WORKS FOR PIANO
OEUVRES POUR PIANO ARNO BABADJANIAN (1921-1983)
« Seules les idées musicales inspirées par la passion peuvent véritablement émouvoir l’auditeur, » écrivait Arno Babadjanian. Etonnant parcours musical que celui de ce pianiste et compositeur arménien au carrefour de plusieurs influences musicales, liant folklore et musiques populaires à toutes les grandes influences du xxe siècle, de l’écriture rythmique d’un Bartók au dodécaphonisme de Schoenberg, en passant par le jazz ou le rock’n’roll.
Né à Erevan en 1921, mort dans la même ville en 1983 des suites d’une leucémie, Arno Babadjanian présente très tôt des dispositions pour la musique. Il entre au conservatoire à l’âge de sept ans, et écrit sa première composition, La Valse des pionniers, deux ans plus tard. Doué d’une excellente mémoire et très bon lecteur à vue, il étudie auprès du compositeur arménien Sergueï Barkhoudarian (1887-1973) puis au Conservatoire de Moscou dans la classe de Constantin Igoumnov (1873-1948) avec qui il approfondit sa connaissance de la musique de Bach, dont le contrepoint le fascine, ainsi que de Beethoven, Chopin et Rachmaninov. Diplômé des classes de piano et composition en 1948, il retourne en Arménie où il obtient un poste de professeur au Conservatoire d’Erevan. Son catalogue comprend une vingtaine d’opus pour piano seul ou deux pianos, plusieurs oeuvres de musique de chambre dont son célèbre Trio avec piano en fa dièse mineur, créé en 1952 par le violoniste David Oïstrakh, le violoncelliste Sviatoslav Knoushevitski et le compositeur lui-même au piano, ainsi que plusieurs oeuvres orchestrales, comme son Poème-Rhapsodie de 1954, son concerto pour piano (1944), ses concertos pour violon (1948) et violoncelle (1962) ainsi que sa Ballade héroïque pour piano et orchestre (1950). A cela s’ajoutent des oeuvres scéniques, pour le théâtre ou le ballet, ainsi que des musiques de film, comme La Chanson du premier amour (1958) ainsi que des chansons teintées de folklore arménien. La Sonate polyphonique, écrite en 1946, révisée en 1956, constitue peut-être l’oeuvre majeure du compositeur, à la fois « par sa complexité technique, rythmique, mais aussi par son écriture polyphonique » (Sona Igityan). Elle s’ouvre sur un Prélude rapide, marcato, léger et pétillant. Suit une Fugue dont le thème poignant, orné de trilles, monte par vagues déchirantes, jusqu’à un fortissimo (noté ffff sur la partition) avant de s’apaiser pour finir pianissimo[1], avec une main gauche staccato dans les graves évoquant les battements d’un coeur qui peu à peu vient à s’arrêter. Cela n’est pas sans rappeler que l’écriture de la Sonate date des années d’étude du compositeur auprès de Khatchatourian mais aussi de Genrikh Litinski (1901-1985), contrapuntiste de talent. Sans doute cette fugue se ressent-elle de cette influence[2]. Le troisième mouvement, Toccata rythmée et marcato, retrouve l’esprit de jeu et d’invention propre à l’écriture de la toccata baroque, entrelaçant deux thèmes qui se révèlent le même thème dans deux tempi différents, jusqu’à l’explosion d’un feu d’artifice sonore.
Composées vingt ans plus tard, les Six images pour piano (1964) témoignent d’une autre source d’inspiration du compositeur et marquent un jalon dans la musique arménienne, en mêlant inspiration populaire et musique sérielle et atonale. En effet, depuis la fin des années 1950, le compositeur se passionne pour le langage de la Seconde école de Vienne[3], qu’il nourrit, dans ces six miniatures, de sa marque stylistique – la nature, l’émotion et une couleur populaire omniprésente dans son oeuvre.
Le cycle s’ouvre sur une Improvisation, rappelant, dans un tout autre genre, les Préludes non-mesurés d’un Louis Couperin; si tout est noté avec précision sur la partition, elle garde un caractère libre. Selon la musicologue Svetlana Sarkissian, l’introduction rappellerait le thème principal du Survivant de Varsovie de Schönberg[4]. Ensuite, La Populaire, pièce pleine de fantaisie, giocoso, est construite sur des rythmes pointés rappelant des danses folkloriques traditionnelles, encadrant un intermède lyrique. La musicologue américaine Nune Melikyan a vu dans la Toccatina l’évocation d’un « paysage urbain avec ses machines sans fin et ses usines en activité »; il est vrai que ses septièmes mineures et tritons agressifs suggèrent le mouvement perpétuel de machines sempiternellement en marche[5]. Lui succède un Intermezzo qui, par son caractère improvisé, rappelle la première Image, et, par son thème dodécaphonique, renvoie à la Populaire : le cycle se construit donc dans ces échos et effets de miroir. L’Intermezzo contraste avec le Choral, lent et méditatif, construit sur un ostinato qui lui confère cette impression de calme et d’immobilité; son thème s’alourdit peu à peu pour culminer pianissimo avant le retour de son caractère grave. Enfin, la Danse de Sassoun termine le cycle en une ronde traditionnelle arménienne dansée par des groupes d’hommes, le « kochari ». La pièce a la particularité de changer de mesure à chaque mesure : 5/8, 4/8, 7/8, 5/8, 4/8, 7/8, 3/8, 5/8, etc. La ville de Sassoun est l’un des sites les plus importants du Grand Empire arménien (entre 190 avant J.-C. et 428 de notre ère); elle est également la dernière ville à avoir combattu l’Empire ottoman durant le génocide de 1915, tenant le siège durant six mois; ses danses militaires sont devenues « des symboles de bravoure, d’héroïsme et de patriotisme »[6]. Encore une fois, le folklore rejoint un langage sériel. Le compositeur anglais Benjamin Britten, en voyage en Arménie en 1965, assista à une audition des Six images par le compositeur et aurait été fasciné par la construction rythmique de cette pièce.
Les Quatre pièces ont été écrites à différentes périodes de la vie du compositeur, mais il les a lui-même souvent jouées ensemble et dans cet ordre précis, si bien qu’elles ont fini par constituer dans l’esprit du public un cycle de pièces sur des thèmes traditionnels arméniens. Le Prélude, composé en 1943, en si bémol mineur développe un thème élégiaque qui s’élance comme un appel. Dans la tonalité homonyme de si bémol majeur, s’élance l’ample Danse de Vagharshapat de 1943, mêlant à une pulsation affirmée un thème brillant, lyrique, presque romantique, construit sur le chant Yerangi (« nuances ») du père Komitas (1869- 1935), le célèbre prêtre et musicologue arménien qui fit connaître la culture arménienne en Europe occidentale. Composé un an plus tard, l’Impromptu en si mineur, dans la même veine mélodique, évoque des danses de femmes puis d’hommes. Enfin, c’est en 1952 qu’Arno Babadjanian compose son Capriccio en ré bémol majeur, associant à l’ampleur mélodique et rhapsodique des précédentes pièces un rythme pulsé de valse et une dimension brillante et virtuose.
La Mélodie est une longue mélopée nostalgique. Elle est associée à l’Humoresque, également composée en 1970. Le compositeur les écrivit pour son fils Ara, sur la demande de son professeur; ce sont des pièces faciles, destinées à être introduites dans le programme d’examen de l’école de musique. Tandis que l’Andante rappelle le style de Rachmaninov, l’Humoresque est un scherzo fantaisiste et plein d’humour, teinté d’une influence du jazz.
Bien qu’écrite en 1969, la pièce intitulée Réflexion n’a été éditée qu’en 2006. C’est une méditation; atonale et dissonante, elle est le reflet d’un état d’esprit méditatif et inquiet.
Enfin, le Poème a été composé pour le Concours Tchaïkovski. Pour son édition de 1966, le ministère de la Culture avait mis au concours la composition d’une oeuvre imposée pour la deuxième épreuve, qui devait recourir à toutes les possibilités techniques de l’instrument. Le Poème de Babadjanian fut retenu parmi douze candidats. Elle comporte deux parties contrastées : un Andante cantabile puis un Presto brillante virtuose et enfiévré; lors de sa création, elle reçut un accueil chaleureux du public.
[1] L’auteure remercie Sona Igityan pour ses commentaires sur l’oeuvre interprétée sur ce disque.
[2] Genrikh Litinski est l’auteur par exemple des ouvrages L’art polyphonique soviétique (1954) and Exercices de polyphonie pour compositeurs (1965), et son article « Quelques aspects de l’école soviétique de composition » établira en 1986 l’école de contrepoint soviétique moderne. Source: Nune Melikyan, Arno Babadjanian: an Armenian Composer in the Soviet Context, p. 23.
[3] Source : Svetlana Sarskissian, Dedicated to Arno Babadjanian, Erevan, Antares, 2008, p. 24, cité par Nune Melikyan, op. cit.
[4] Svetlana Sarskissian, article de 2011, p. 32, cité par Nune Melikyan, op. cit.
[5] Nune Melikyan, op. cit., p. 57.
[6] Nune Melikyan, op. cit., p. 58.
SONA IGITYAN
Née dans une famille d’artistes et de musiciens, Sona Igityan commence ses études à l’âge de 7 ans dans l’école de musique Sayat-Nova, l’une des plus prestigieuses écoles d’Erevan, sa ville natale. C’est avec Vénus Haroutunian, professeur d’exception et d’une grande sensibilité, que Sona commence son apprentissage de la musique. C’est en grande partie grâce à sa première enseignante que son jeu s’est très vite distingué par une sonorité particulièrement profonde et veloutée, ainsi que par une extraordinaire souplesse pianistique. Trois ans plus tard, Sona donne une interprétation très remarquée du concerto de Bach en sol mineur avec l’Orchestre de Chambre National d’Arménie.
À 12 ans elle est sélectionnée pour jouer à la Radio Nationale et à 17 ans elle obtient le prix de la meilleure interprétation au Festival « Les Nouveaux Noms » à Erevan. Sona Igityan bénéficie par la suite des conseils de maîtres tels que Willy Sarkisian en Arménie, Elisabeth Athanassova, Michel Kiener, Jean-Jacques Balet et Paul Coker en Suisse et Paco Moya en Espagne. Elle obtient ses diplômes de soliste, de musique de chambre, d’enseignement et d’accompagnement au Conservatoire d’Etat Komitas d’Erevan en Arménie en 1996 et ses Masters en Interprétation musicale et Pédagogie musicale à la HEM de Genève en 2007 et en 2009.
Dès lors, Sona Igityan poursuit sa carrière de pianiste concertiste et se produit régulièrement en récital, en soliste avec orchestre et en musique de chambre dans différentes villes d’Arménie, d’Allemagne, des Pays-Bas, de Suisse, de France et d’Espagne. En Suisse elle apparaît régulièrement lors d’événements musicaux tels que les « Concerts d’été en Vieille-Ville » à Genève, le Festival du Jura, le Festival de piano «Concertus Saisonnus », la Fête de la Musique, heures musicales de la Galerie «La Primaire », le «Monde à part », l’Espace Fusterie, LeClavier. ch, Centre Phénix à Fribourg, 20heures de Musique à Romont, PianoFest Moudon. Le répertoire de Sona Igityan comprend des périodes et des styles différents, de la musique baroque à la musique contemporaine. Ayant une prédilection pour la musique du 20ème siècle, elle a, à plusieurs reprises, été invitée à créer des oeuvres de compositeurs contemporains, tels qu’Ashot Zohrabian, Eduard Sadoyan, Karl Haydmayer, Shauna Beesley. Même si Sona s’intéresse à d’autres expressions d’art comme le théâtre, le cinéma, la littérature, pour elle la musique se tient au-delà de tout et représente une vérité absolue.
(2025) Arno Babadjanian: Works for piano - CD 3131
OEUVRES POUR PIANO ARNO BABADJANIAN (1921-1983)
« Seules les idées musicales inspirées par la passion peuvent véritablement émouvoir l’auditeur, » écrivait Arno Babadjanian. Etonnant parcours musical que celui de ce pianiste et compositeur arménien au carrefour de plusieurs influences musicales, liant folklore et musiques populaires à toutes les grandes influences du xxe siècle, de l’écriture rythmique d’un Bartók au dodécaphonisme de Schoenberg, en passant par le jazz ou le rock’n’roll.
Né à Erevan en 1921, mort dans la même ville en 1983 des suites d’une leucémie, Arno Babadjanian présente très tôt des dispositions pour la musique. Il entre au conservatoire à l’âge de sept ans, et écrit sa première composition, La Valse des pionniers, deux ans plus tard. Doué d’une excellente mémoire et très bon lecteur à vue, il étudie auprès du compositeur arménien Sergueï Barkhoudarian (1887-1973) puis au Conservatoire de Moscou dans la classe de Constantin Igoumnov (1873-1948) avec qui il approfondit sa connaissance de la musique de Bach, dont le contrepoint le fascine, ainsi que de Beethoven, Chopin et Rachmaninov. Diplômé des classes de piano et composition en 1948, il retourne en Arménie où il obtient un poste de professeur au Conservatoire d’Erevan. Son catalogue comprend une vingtaine d’opus pour piano seul ou deux pianos, plusieurs oeuvres de musique de chambre dont son célèbre Trio avec piano en fa dièse mineur, créé en 1952 par le violoniste David Oïstrakh, le violoncelliste Sviatoslav Knoushevitski et le compositeur lui-même au piano, ainsi que plusieurs oeuvres orchestrales, comme son Poème-Rhapsodie de 1954, son concerto pour piano (1944), ses concertos pour violon (1948) et violoncelle (1962) ainsi que sa Ballade héroïque pour piano et orchestre (1950). A cela s’ajoutent des oeuvres scéniques, pour le théâtre ou le ballet, ainsi que des musiques de film, comme La Chanson du premier amour (1958) ainsi que des chansons teintées de folklore arménien. La Sonate polyphonique, écrite en 1946, révisée en 1956, constitue peut-être l’oeuvre majeure du compositeur, à la fois « par sa complexité technique, rythmique, mais aussi par son écriture polyphonique » (Sona Igityan). Elle s’ouvre sur un Prélude rapide, marcato, léger et pétillant. Suit une Fugue dont le thème poignant, orné de trilles, monte par vagues déchirantes, jusqu’à un fortissimo (noté ffff sur la partition) avant de s’apaiser pour finir pianissimo[1], avec une main gauche staccato dans les graves évoquant les battements d’un coeur qui peu à peu vient à s’arrêter. Cela n’est pas sans rappeler que l’écriture de la Sonate date des années d’étude du compositeur auprès de Khatchatourian mais aussi de Genrikh Litinski (1901-1985), contrapuntiste de talent. Sans doute cette fugue se ressent-elle de cette influence[2]. Le troisième mouvement, Toccata rythmée et marcato, retrouve l’esprit de jeu et d’invention propre à l’écriture de la toccata baroque, entrelaçant deux thèmes qui se révèlent le même thème dans deux tempi différents, jusqu’à l’explosion d’un feu d’artifice sonore.
Composées vingt ans plus tard, les Six images pour piano (1964) témoignent d’une autre source d’inspiration du compositeur et marquent un jalon dans la musique arménienne, en mêlant inspiration populaire et musique sérielle et atonale. En effet, depuis la fin des années 1950, le compositeur se passionne pour le langage de la Seconde école de Vienne[3], qu’il nourrit, dans ces six miniatures, de sa marque stylistique – la nature, l’émotion et une couleur populaire omniprésente dans son oeuvre.
Le cycle s’ouvre sur une Improvisation, rappelant, dans un tout autre genre, les Préludes non-mesurés d’un Louis Couperin; si tout est noté avec précision sur la partition, elle garde un caractère libre. Selon la musicologue Svetlana Sarkissian, l’introduction rappellerait le thème principal du Survivant de Varsovie de Schönberg[4]. Ensuite, La Populaire, pièce pleine de fantaisie, giocoso, est construite sur des rythmes pointés rappelant des danses folkloriques traditionnelles, encadrant un intermède lyrique. La musicologue américaine Nune Melikyan a vu dans la Toccatina l’évocation d’un « paysage urbain avec ses machines sans fin et ses usines en activité »; il est vrai que ses septièmes mineures et tritons agressifs suggèrent le mouvement perpétuel de machines sempiternellement en marche[5]. Lui succède un Intermezzo qui, par son caractère improvisé, rappelle la première Image, et, par son thème dodécaphonique, renvoie à la Populaire : le cycle se construit donc dans ces échos et effets de miroir. L’Intermezzo contraste avec le Choral, lent et méditatif, construit sur un ostinato qui lui confère cette impression de calme et d’immobilité; son thème s’alourdit peu à peu pour culminer pianissimo avant le retour de son caractère grave. Enfin, la Danse de Sassoun termine le cycle en une ronde traditionnelle arménienne dansée par des groupes d’hommes, le « kochari ». La pièce a la particularité de changer de mesure à chaque mesure : 5/8, 4/8, 7/8, 5/8, 4/8, 7/8, 3/8, 5/8, etc. La ville de Sassoun est l’un des sites les plus importants du Grand Empire arménien (entre 190 avant J.-C. et 428 de notre ère); elle est également la dernière ville à avoir combattu l’Empire ottoman durant le génocide de 1915, tenant le siège durant six mois; ses danses militaires sont devenues « des symboles de bravoure, d’héroïsme et de patriotisme »[6]. Encore une fois, le folklore rejoint un langage sériel. Le compositeur anglais Benjamin Britten, en voyage en Arménie en 1965, assista à une audition des Six images par le compositeur et aurait été fasciné par la construction rythmique de cette pièce.
Les Quatre pièces ont été écrites à différentes périodes de la vie du compositeur, mais il les a lui-même souvent jouées ensemble et dans cet ordre précis, si bien qu’elles ont fini par constituer dans l’esprit du public un cycle de pièces sur des thèmes traditionnels arméniens. Le Prélude, composé en 1943, en si bémol mineur développe un thème élégiaque qui s’élance comme un appel. Dans la tonalité homonyme de si bémol majeur, s’élance l’ample Danse de Vagharshapat de 1943, mêlant à une pulsation affirmée un thème brillant, lyrique, presque romantique, construit sur le chant Yerangi (« nuances ») du père Komitas (1869- 1935), le célèbre prêtre et musicologue arménien qui fit connaître la culture arménienne en Europe occidentale. Composé un an plus tard, l’Impromptu en si mineur, dans la même veine mélodique, évoque des danses de femmes puis d’hommes. Enfin, c’est en 1952 qu’Arno Babadjanian compose son Capriccio en ré bémol majeur, associant à l’ampleur mélodique et rhapsodique des précédentes pièces un rythme pulsé de valse et une dimension brillante et virtuose.
La Mélodie est une longue mélopée nostalgique. Elle est associée à l’Humoresque, également composée en 1970. Le compositeur les écrivit pour son fils Ara, sur la demande de son professeur; ce sont des pièces faciles, destinées à être introduites dans le programme d’examen de l’école de musique. Tandis que l’Andante rappelle le style de Rachmaninov, l’Humoresque est un scherzo fantaisiste et plein d’humour, teinté d’une influence du jazz.
Bien qu’écrite en 1969, la pièce intitulée Réflexion n’a été éditée qu’en 2006. C’est une méditation; atonale et dissonante, elle est le reflet d’un état d’esprit méditatif et inquiet.
Enfin, le Poème a été composé pour le Concours Tchaïkovski. Pour son édition de 1966, le ministère de la Culture avait mis au concours la composition d’une oeuvre imposée pour la deuxième épreuve, qui devait recourir à toutes les possibilités techniques de l’instrument. Le Poème de Babadjanian fut retenu parmi douze candidats. Elle comporte deux parties contrastées : un Andante cantabile puis un Presto brillante virtuose et enfiévré; lors de sa création, elle reçut un accueil chaleureux du public.
[1] L’auteure remercie Sona Igityan pour ses commentaires sur l’oeuvre interprétée sur ce disque.
[2] Genrikh Litinski est l’auteur par exemple des ouvrages L’art polyphonique soviétique (1954) and Exercices de polyphonie pour compositeurs (1965), et son article « Quelques aspects de l’école soviétique de composition » établira en 1986 l’école de contrepoint soviétique moderne. Source: Nune Melikyan, Arno Babadjanian: an Armenian Composer in the Soviet Context, p. 23.
[3] Source : Svetlana Sarskissian, Dedicated to Arno Babadjanian, Erevan, Antares, 2008, p. 24, cité par Nune Melikyan, op. cit.
[4] Svetlana Sarskissian, article de 2011, p. 32, cité par Nune Melikyan, op. cit.
[5] Nune Melikyan, op. cit., p. 57.
[6] Nune Melikyan, op. cit., p. 58.
SONA IGITYAN
Née dans une famille d’artistes et de musiciens, Sona Igityan commence ses études à l’âge de 7 ans dans l’école de musique Sayat-Nova, l’une des plus prestigieuses écoles d’Erevan, sa ville natale. C’est avec Vénus Haroutunian, professeur d’exception et d’une grande sensibilité, que Sona commence son apprentissage de la musique. C’est en grande partie grâce à sa première enseignante que son jeu s’est très vite distingué par une sonorité particulièrement profonde et veloutée, ainsi que par une extraordinaire souplesse pianistique. Trois ans plus tard, Sona donne une interprétation très remarquée du concerto de Bach en sol mineur avec l’Orchestre de Chambre National d’Arménie.
À 12 ans elle est sélectionnée pour jouer à la Radio Nationale et à 17 ans elle obtient le prix de la meilleure interprétation au Festival « Les Nouveaux Noms » à Erevan. Sona Igityan bénéficie par la suite des conseils de maîtres tels que Willy Sarkisian en Arménie, Elisabeth Athanassova, Michel Kiener, Jean-Jacques Balet et Paul Coker en Suisse et Paco Moya en Espagne. Elle obtient ses diplômes de soliste, de musique de chambre, d’enseignement et d’accompagnement au Conservatoire d’Etat Komitas d’Erevan en Arménie en 1996 et ses Masters en Interprétation musicale et Pédagogie musicale à la HEM de Genève en 2007 et en 2009.
Dès lors, Sona Igityan poursuit sa carrière de pianiste concertiste et se produit régulièrement en récital, en soliste avec orchestre et en musique de chambre dans différentes villes d’Arménie, d’Allemagne, des Pays-Bas, de Suisse, de France et d’Espagne. En Suisse elle apparaît régulièrement lors d’événements musicaux tels que les « Concerts d’été en Vieille-Ville » à Genève, le Festival du Jura, le Festival de piano «Concertus Saisonnus », la Fête de la Musique, heures musicales de la Galerie «La Primaire », le «Monde à part », l’Espace Fusterie, LeClavier. ch, Centre Phénix à Fribourg, 20heures de Musique à Romont, PianoFest Moudon. Le répertoire de Sona Igityan comprend des périodes et des styles différents, de la musique baroque à la musique contemporaine. Ayant une prédilection pour la musique du 20ème siècle, elle a, à plusieurs reprises, été invitée à créer des oeuvres de compositeurs contemporains, tels qu’Ashot Zohrabian, Eduard Sadoyan, Karl Haydmayer, Shauna Beesley. Même si Sona s’intéresse à d’autres expressions d’art comme le théâtre, le cinéma, la littérature, pour elle la musique se tient au-delà de tout et représente une vérité absolue.
Return to the album | Read the booklet | Open online links | Composer(s): Arno Babadjanian | Main Artist: Sona Igityan