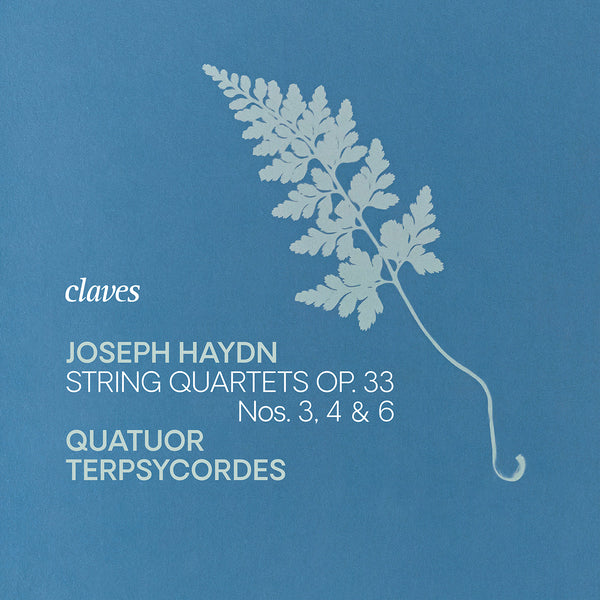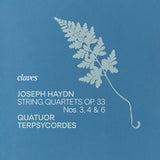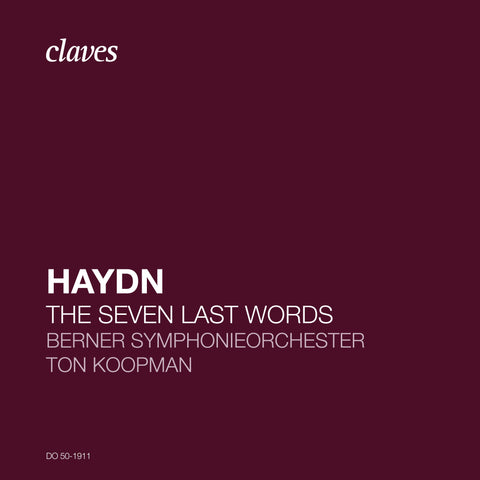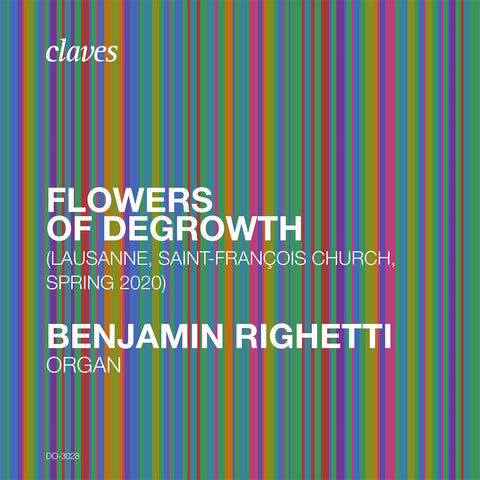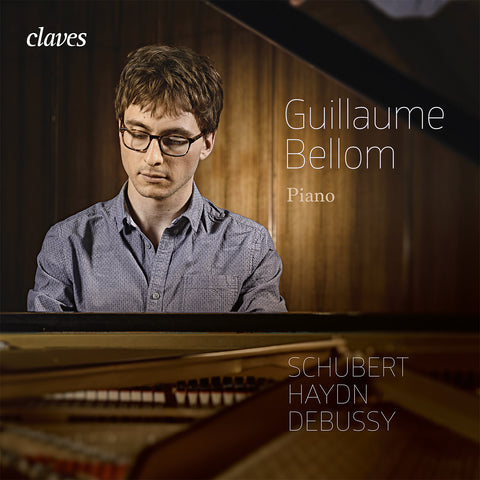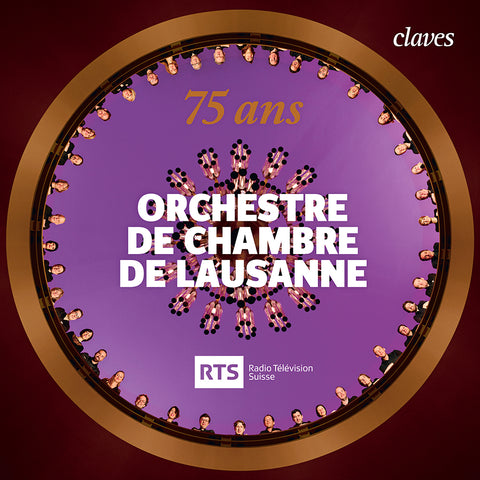(2025) Haydn: String Quartets, Op. 33, Nos. 3,4,6
Catégorie(s): Musique de Chambre
Instrument(s): Violoncelle Alto Violon
Compositeur principal: Joseph Haydn
Ensemble: Quatuor Terpsycordes
Nb CD(s): 1
N° de catalogue:
CD 3112
Sortie: 07.11.2025
EAN/UPC: 7619931311227
Cet album est en repressage. Précommandez-le dès maintenant à un prix spécial.
CHF 18.50
Cet album n'est plus disponible en CD.
Cet album n'est pas encore sorti. Précommandez-le dès maintenant.
CHF 18.50
Cet album n'est plus disponible en CD.
CHF 18.50
TVA incluse pour la Suisse et l'UE
Frais de port offerts
Cet album n'est plus disponible en CD.
TVA incluse pour la Suisse et l'UE
Frais de port offerts
Cet album est en repressage. Précommandez-le dès maintenant à un prix spécial.
CHF 18.50
Cet album n'est plus disponible en CD.
This album has not been released yet.
Pre-order it at a special price now.
CHF 18.50
Cet album n'est plus disponible en CD.
CHF 18.50
Cet album n'est plus disponible en CD.
HAYDN: STRING QUARTETS, OP. 33, NOS. 3,4,6
JOSEPH HAYDN, QUATUORS OP. 33 N° 3, 4 ET 6
Joseph Haydn disait volontiers avoir eu une « destinée exemplaire » : parti de rien, il devint l’un des compositeurs les plus célèbres de son temps. Il naît à Rohrau, à une cinquantaine de kilomètres à l’Est de Vienne, dans une famille relativement modeste – son père était charron, maître artisan reconnu et respecté. Très vite on observe chez l’enfant des dispositions pour la musique; il est alors envoyé à Hainburg, puis Vienne comme chantre à la cathédrale Saint-Etienne, jusqu’à ses seize ans. Son ferme refus d’embrasser la carrière ecclésiastique le pousse à la rue; il rencontre alors le célèbre maître de chapelle Porpora qui l’engage comme accompagnateur pour ses leçons de chant, le faisant dormir dans une mansarde où il arrivait que la neige s’infiltrât jusqu’à son lit durant l’hiver, mais lui permettant d’apprendre l’italien, le chant et la composition. Mais ce sont des quatuors qui lanceront sa carrière : en 1757, le jeune Haydn compose ses premiers quatuors (les op. 1 et 2) pour le baron Fürnberg. D’un genre nouveau, différents des divertissements habituels, ils remportent rapidement un immense succès, et l’on en retrouve des copies dans toute l’Europe. Peu de temps après, le compositeur est nommé maître de chapelle et, un an plus tard, après son mariage malheureux avec Maria-Anna Keller, il entre au service du prince Paul Anton Esterházy, l’une des familles les plus fortunées de Hongrie. Très attaché au prince Nicolas, il y restera trente ans, composant pour les deux théâtres du domaine d’Esterháza presque tous ses opéras et la plupart de ses oeuvres symphoniques et de musique de chambre, avant de découvrir Londres durant deux séjours durant lesquels il est célébré triomphalement. De retour à Vienne en 1795, il compose encore les plus célèbres de ses oratorios et messes et bien d’autres oeuvres jusqu’à sa mort, le 31 mai 1809, deux semaines après la capitulation de Vienne devant les troupes de Napoléon.
Si Joseph Haydn est l’un des musiciens les plus importants de son temps, tant par le nombre de ses oeuvres que par son apport dans les différents genres, il reste le fondateur, avec Boccherini, du quatuor à cordes, un genre nouveau qui met à égalité quatre instruments de la même famille, les faisant dialoguer en se passant de basse continue. On a longtemps attribué au compositeur quatre-vingt-trois quatuors à cordes, en s’appuyant sur leur édition complète par son élève Ignaz Pleyel en 1801; aujourd’hui, leur nombre se porte à soixante-huit, sur une période de 1757 à 1803, soit de la naissance du genre au portes du romantisme.
Dans cette riche production, les six quatuors op. 33 occupent une place centrale. Composés entre juin et novembre 1781, « ils sont d’un genre tout à fait nouveau et particulier, car je n’en ai pas écrit depuis dix ans », affirme le compositeur. Haydn, alors connu dans toute l’Europe, a déjà écrit une trentaine de quatuors, et en écrira encore plus d’une trentaine. En quoi consiste donc ce genre « nouveau et particulier » ? D’abord, dans un changement de ton; si le quatuor reste une oeuvre dite « savante », il intègre une dimension véritablement populaire, comme en témoignent les finales en forme de rondo; ensuite, les pièces sont plus concises et le ton plus léger – l’humour caractéristique du compositeur s’y fait jour – tout en « [cachant] le plus souvent une grande complexité interne » (Orin Moe), puisque le compositeur se plaît à développer chaque petit élément thématique. Ces quatuors auront une influence déterminante sur le jeune Mozart et feront de nombreux émules, tels Franz Hoffmeister et Ignaz Pleyel, contribuant à pérenniser la forme du quatuor à cordes.
Surnommé « L’Oiseau », le troisième quatuor de l’opus 33 (Hob.III.39) s’ouvre sur un thème descendant sur deux octaves au premier violon, évoquant peut-être les trilles d’un oiseau, un petit motif en doubles croches de la mélodie se trouvant immédiatement repris comme formule d’accompagnement par l’alto et le violoncelle. Cette ambiguïté entre mélodie et accompagnement est l’une des caractéristiques du style de Haydn « visant la recherche de l’unité dans la diversité »; parfois trait d’humour, ils s’adressent surtout « aux connaisseurs capables d’en apprécier le raffinement et l’esprit » (Frédéric Gonin). Le deuxième mouvement, Scherzando, commence avec les quatre voix en homophonie, en do majeur, dans une dynamique piano, contrastant avec le dialogue léger des deux violons, seuls protagonistes du trio. L’Adagio, en fa majeur, est tendre et expressif, puis dramatique dans sa partie centrale; c’est « le dernier mouvement de quatuor chez Haydn à faire usage de la reprise variée chère à Carl Philipp Emanuel Bach », tandis que le Presto final, au ton très populaire, est « le premier » des quatuors du compositeur « à porter expressément la dénomination de rondo » (M. Vignal) : on comprend alors que l’opus 33 soit considéré comme un véritable pivot stylistique.
Le quatrième quatuor op. 33 (Hob.III.40), en si bémol majeur, s’ouvre par un Allegro moderato dont le thème est caractéristique de l’humour de Haydn, qui aimait surprendre par des mélodies qui n’adoptent pas le schéma habituel « élan, point culminant, désinence » : le thème, au premier violon, s’élance sur un motif cadentiel répété et souligné par les trilles. Quelques mesures plus loin, le compositeur répète trois fois la cellule fa-fa-ré, avant que celle-ci ne réapparaisse au violoncelle, comme si ce dernier n’avait pas su s’arrêter à temps ! Plaisanterie dont se souviendra Mozart dans le finale de son quatuor K. 458 dédié à Haydn et dans la même tonalité. D’autres surprises attendent l’auditeur de cette Allegro de forme sonate. Le scherzo qui suit, à trois temps binaires, rappelle le menuet, encadrant un trio en mineur, avant le beau Largo en mi bémol, construit en trois parties autour des trois itérations du thème principal : d’abord énoncé, puis développé dans un discours très modulant, il réapparaît dans un majeur lumineux, puis connaît de nouveaux développements, avant sa troisième apparition et la coda. Le finale est un nouvel exemple de l’humour caractéristique de Haydn. Construit comme un rondo de structure A-B-A’-C-A’’, il passe par des modulations donnant parfois l’impression d’une fausse note et se termine par une coda dans laquelle le thème est troué de silences, puis s’étend en valeurs longues, avant une fin en pizzicati, comme une boutade, prouvant, une fois encore que l’humour de Haydn, compositeur à la fois sérieux et jovial selon ses contemporains, relève « d’une réflexion esthétique et analytique suffisamment profonde et élevée pour que [ …] [l’] on continue aujourd’hui encore à l’apprécier avec délectation » (F. Gonin).
Enfin, le sixième quatuor op. 33 (Hob.III.42) est en ré majeur. D’une construction subtile, jouant sur de petits motifs, son premier mouvement expose un thème de huit mesures dont les quatre dernières sont la variation des quatre premières, et surprend son auditeur par une fausse réexposition, avant la véritable réexposition … qui ne reprend que la partie variée du thème. Vient l’apaisant et méditatif Andante en ré mineur, dont le thème est exposé au deuxième violon sur une longue tenue du premier violon, avant un véritable dialogue entre les quatre instruments. Le Scherzo, aux temps et accents bien marqués, laisse la part belle au violoncelle dans le trio, avant la reprise du scherzo. Le Finale, tranquille, est une suite de variations (A-B-A’-B’-A’’-B’’), alternant une partie majeure et une mineure et, petite plaisanterie, une fausse fin avant la fin véritable.
Joseph Haydn avait l’habitude de tenir le premier violon lors de l’interprétation de ses quatuors, comme le rapporte dans ses souvenirs en 1784 le compositeur italien Giovanni Paisiello, venu à Vienne pour l’un de ses opéras; l’alto était alors joué par Wolfgang Amadeus Mozart, qui confia au sujet de son mentor, de vingt-quatre ans son aîné : « Lui seul a le secret de me faire sourire, de me toucher au plus profond de mon âme … » Gageons que ces quatuors, où le complexe s’allie à l’humour, le savant au populaire, sauront toucher leurs auditeurs.
Bénédicte Gandois
Bibliographie
Vignal, Marc, « Haydn », in François-René Tranchefort, Guide de la musique de chambre, Fayard, Paris, 1989.
Gonin, Frédéric, Quatre regards sur les quatuors de Joseph Haydn, Delatour-France, Sampzon, 2012.
Barbaud, Pierre, Haydn, Seuil, coll. Solfèges, 1963.
Robbins Landon, H. C., Haydn, Chêne/ Hachette, Paris, 1981.
QUATUOR TERPSYCORDES
Le Quatuor Terpsycordes redéfinit le lien entre un ensemble musical et son public. Il invente de nouvelles manières d’écouter un concert de musique de chambre et s’engage autant auprès des publics empêchés que des jeunes, pour transmettre son art au plusgrand nombre.
Le Quatuor Terpsycordes est l’histoire d’une amitié qui perdure depuis plus de 25 ans. Formé à Genève en 1997, guidé par la vision artistique de GáborTakács-Nagy et nourri par l’enseignement des membres des quatuors Amadeus, Budapest, Hagen, Lasalle et Mosaïques, le Quatuor Terpsycordes conquiert rapidement la scène musicale en remportant notamment le Premier Prixdu Concours de Genève en 2001. La rencontre avec des compositeurs majeurs du 20e siècle (György Kurtág, Sofia Goubaïdoulina), de même qu’avec des personnalités du monde baroque (Gabriel Garrido, Chiara Banchini, Florence Malgoire, Leonardo García Alarcón) contribue à définir et affiner l’évolution esthétique du Quatuor. Ses membres continuent aujourd’hui de collaborer régulièrement avec des partenaires de différents horizons, en intégrant des ensembles tels que l’Orchestre de Chambre de Genève, la Cappella Mediterranea, GliAngeli Genève, Contrechamps, l’Armée des Romantiques ou Elyma. Ces expériences permettent au Quatuor Terpsycordes de porter un regard toujours nouveau sur son répertoire. La prise de liberté et de risque est au coeur de sa démarche, marquée par une constante recherche d’équilibre entre cohésion de groupe et expression individuelle, respect du texte et indépendance face à la partition.
Le répertoire du Quatuor Terpsycordes s’étend de la période préclassique à la création contemporaine. Depuis 2021, il poursuit une intégrale sur instruments d’époque des quatuors de Joseph Haydn au Musée d’art et d’histoire de Genève, tout en entretenant une relation privilégiée avec les compositeurs genevois du 20e siècle. La publication, au printemps 2024 chez Claves Records, d’un nouvel album entièrement consacré à l’oeuvre de Frank Martin vient enrichir une discographie acclamée par la critique, qui aborde autant Haydn que Piazzolla.
Le Quatuor Terpsycordes s’engage activement dans des projets sociaux et éducatifs : il offre des concerts en partenariat avec des fondations, des associations et des établissements d’accueil pour les personnes en situation de handicap, de précarité ou de détention. Il collabore également avec des élèves des écoles de la Ville de Genève. Il transcende les conventions en offrant des expériences uniques visant à partager sa passion : que ce soit à travers des concerts en plein air dans des lieux insolites, des balades musicales à vélo ou des répétitions publiques, il crée des opportunités originales pour faire découvrir la magie de la musique de chambre à de nombreux publics.
Le Quatuor Terpsycordes bénéficie du soutien de la Ville de Genève et de la République et canton de Genève.
Girolamo Bottiglieri - violon
Raya Raytcheva - violon
Caroline Cohen-Adad - alto
Florestan Darbellay - violoncelle
REVIEWS
"[..] La primera de ellas está dedicada a la segunda triada del magnífico Op. 33 de Haydn. Se da la extraña circunstancia de que el primer disco del Op. 33 (5, 2, 1) del Quatuor Terpsycordes se publicó en 2006. Más vale tarde que nunca: 19 años después, este cuarteto fundado en Ginebra remata la serie con los últimos 3 Cuartetos, siguiendo el orden de la edición de Artaria (5, 2, 1, 3, 6, 4). Llaman la atención el laconismo y la viveza con la que el Terpsycordes acomete el primer movimiento del n. 3 (apodado El pájaro, en esta versión queda claro por qué). Sobresalen también los primeros rondós que Haydn incorpora al género (ns. 3 y 6), adecuadamente feroces. No es imprescindible rescatar a su pareja de baile de 2006, funciona bien como disco aislado. [..]" - Daniel Pérez Navarro, Diciembre 2025
"[..] Ce répertoire est bien connu du Quatuor Terpsycordes, qui depuis 2021 poursuit une intégrale sur instruments d’époque des quatuors de Haydn au Musée d’art et d’histoire de Genève. C’est sur la centralité de l’Opus 33 que l’ensemble se penche pour cette sortie chez Claves, en mettant à l’honneur trois de ces six quatuors. Les Genevois·es font cela avec un brio, un ravissant cisèlement expressif de l’engrenage polyphonique, une légèreté et une transparence de la diction musicale très philologique, qui illumine ce répertoire avec un équilibre aérien remarquable." - Gianluigi Bocelli, décembre 2025
"Dès son 2e disque en 2006, le Quatuor Terpsycordes abordait l’«Opus 33» de Joseph Haydn avec une pertinence très affûtée pour le jeune ensemble d’alors. Dix-neuf ans plus tard, ils complètent ce monument du classicisme, marqué au sceau de la profondeur et de la légèreté. En 1781, Haydn est au sommet de son art, mais ne lâche rien de son humour. Les Terpsycordes y assument leur maturité en souriant. Car les Genevois ont lancé une intégrale au concert des 68 quatuors à cordes de l’inventif Autrichien. C’est devenu leur langue paternelle!" - Matthieu Chenal, décembre 2025
(2025) Haydn: String Quartets, Op. 33, Nos. 3,4,6 - CD 3112
JOSEPH HAYDN, QUATUORS OP. 33 N° 3, 4 ET 6
Joseph Haydn disait volontiers avoir eu une « destinée exemplaire » : parti de rien, il devint l’un des compositeurs les plus célèbres de son temps. Il naît à Rohrau, à une cinquantaine de kilomètres à l’Est de Vienne, dans une famille relativement modeste – son père était charron, maître artisan reconnu et respecté. Très vite on observe chez l’enfant des dispositions pour la musique; il est alors envoyé à Hainburg, puis Vienne comme chantre à la cathédrale Saint-Etienne, jusqu’à ses seize ans. Son ferme refus d’embrasser la carrière ecclésiastique le pousse à la rue; il rencontre alors le célèbre maître de chapelle Porpora qui l’engage comme accompagnateur pour ses leçons de chant, le faisant dormir dans une mansarde où il arrivait que la neige s’infiltrât jusqu’à son lit durant l’hiver, mais lui permettant d’apprendre l’italien, le chant et la composition. Mais ce sont des quatuors qui lanceront sa carrière : en 1757, le jeune Haydn compose ses premiers quatuors (les op. 1 et 2) pour le baron Fürnberg. D’un genre nouveau, différents des divertissements habituels, ils remportent rapidement un immense succès, et l’on en retrouve des copies dans toute l’Europe. Peu de temps après, le compositeur est nommé maître de chapelle et, un an plus tard, après son mariage malheureux avec Maria-Anna Keller, il entre au service du prince Paul Anton Esterházy, l’une des familles les plus fortunées de Hongrie. Très attaché au prince Nicolas, il y restera trente ans, composant pour les deux théâtres du domaine d’Esterháza presque tous ses opéras et la plupart de ses oeuvres symphoniques et de musique de chambre, avant de découvrir Londres durant deux séjours durant lesquels il est célébré triomphalement. De retour à Vienne en 1795, il compose encore les plus célèbres de ses oratorios et messes et bien d’autres oeuvres jusqu’à sa mort, le 31 mai 1809, deux semaines après la capitulation de Vienne devant les troupes de Napoléon.
Si Joseph Haydn est l’un des musiciens les plus importants de son temps, tant par le nombre de ses oeuvres que par son apport dans les différents genres, il reste le fondateur, avec Boccherini, du quatuor à cordes, un genre nouveau qui met à égalité quatre instruments de la même famille, les faisant dialoguer en se passant de basse continue. On a longtemps attribué au compositeur quatre-vingt-trois quatuors à cordes, en s’appuyant sur leur édition complète par son élève Ignaz Pleyel en 1801; aujourd’hui, leur nombre se porte à soixante-huit, sur une période de 1757 à 1803, soit de la naissance du genre au portes du romantisme.
Dans cette riche production, les six quatuors op. 33 occupent une place centrale. Composés entre juin et novembre 1781, « ils sont d’un genre tout à fait nouveau et particulier, car je n’en ai pas écrit depuis dix ans », affirme le compositeur. Haydn, alors connu dans toute l’Europe, a déjà écrit une trentaine de quatuors, et en écrira encore plus d’une trentaine. En quoi consiste donc ce genre « nouveau et particulier » ? D’abord, dans un changement de ton; si le quatuor reste une oeuvre dite « savante », il intègre une dimension véritablement populaire, comme en témoignent les finales en forme de rondo; ensuite, les pièces sont plus concises et le ton plus léger – l’humour caractéristique du compositeur s’y fait jour – tout en « [cachant] le plus souvent une grande complexité interne » (Orin Moe), puisque le compositeur se plaît à développer chaque petit élément thématique. Ces quatuors auront une influence déterminante sur le jeune Mozart et feront de nombreux émules, tels Franz Hoffmeister et Ignaz Pleyel, contribuant à pérenniser la forme du quatuor à cordes.
Surnommé « L’Oiseau », le troisième quatuor de l’opus 33 (Hob.III.39) s’ouvre sur un thème descendant sur deux octaves au premier violon, évoquant peut-être les trilles d’un oiseau, un petit motif en doubles croches de la mélodie se trouvant immédiatement repris comme formule d’accompagnement par l’alto et le violoncelle. Cette ambiguïté entre mélodie et accompagnement est l’une des caractéristiques du style de Haydn « visant la recherche de l’unité dans la diversité »; parfois trait d’humour, ils s’adressent surtout « aux connaisseurs capables d’en apprécier le raffinement et l’esprit » (Frédéric Gonin). Le deuxième mouvement, Scherzando, commence avec les quatre voix en homophonie, en do majeur, dans une dynamique piano, contrastant avec le dialogue léger des deux violons, seuls protagonistes du trio. L’Adagio, en fa majeur, est tendre et expressif, puis dramatique dans sa partie centrale; c’est « le dernier mouvement de quatuor chez Haydn à faire usage de la reprise variée chère à Carl Philipp Emanuel Bach », tandis que le Presto final, au ton très populaire, est « le premier » des quatuors du compositeur « à porter expressément la dénomination de rondo » (M. Vignal) : on comprend alors que l’opus 33 soit considéré comme un véritable pivot stylistique.
Le quatrième quatuor op. 33 (Hob.III.40), en si bémol majeur, s’ouvre par un Allegro moderato dont le thème est caractéristique de l’humour de Haydn, qui aimait surprendre par des mélodies qui n’adoptent pas le schéma habituel « élan, point culminant, désinence » : le thème, au premier violon, s’élance sur un motif cadentiel répété et souligné par les trilles. Quelques mesures plus loin, le compositeur répète trois fois la cellule fa-fa-ré, avant que celle-ci ne réapparaisse au violoncelle, comme si ce dernier n’avait pas su s’arrêter à temps ! Plaisanterie dont se souviendra Mozart dans le finale de son quatuor K. 458 dédié à Haydn et dans la même tonalité. D’autres surprises attendent l’auditeur de cette Allegro de forme sonate. Le scherzo qui suit, à trois temps binaires, rappelle le menuet, encadrant un trio en mineur, avant le beau Largo en mi bémol, construit en trois parties autour des trois itérations du thème principal : d’abord énoncé, puis développé dans un discours très modulant, il réapparaît dans un majeur lumineux, puis connaît de nouveaux développements, avant sa troisième apparition et la coda. Le finale est un nouvel exemple de l’humour caractéristique de Haydn. Construit comme un rondo de structure A-B-A’-C-A’’, il passe par des modulations donnant parfois l’impression d’une fausse note et se termine par une coda dans laquelle le thème est troué de silences, puis s’étend en valeurs longues, avant une fin en pizzicati, comme une boutade, prouvant, une fois encore que l’humour de Haydn, compositeur à la fois sérieux et jovial selon ses contemporains, relève « d’une réflexion esthétique et analytique suffisamment profonde et élevée pour que [ …] [l’] on continue aujourd’hui encore à l’apprécier avec délectation » (F. Gonin).
Enfin, le sixième quatuor op. 33 (Hob.III.42) est en ré majeur. D’une construction subtile, jouant sur de petits motifs, son premier mouvement expose un thème de huit mesures dont les quatre dernières sont la variation des quatre premières, et surprend son auditeur par une fausse réexposition, avant la véritable réexposition … qui ne reprend que la partie variée du thème. Vient l’apaisant et méditatif Andante en ré mineur, dont le thème est exposé au deuxième violon sur une longue tenue du premier violon, avant un véritable dialogue entre les quatre instruments. Le Scherzo, aux temps et accents bien marqués, laisse la part belle au violoncelle dans le trio, avant la reprise du scherzo. Le Finale, tranquille, est une suite de variations (A-B-A’-B’-A’’-B’’), alternant une partie majeure et une mineure et, petite plaisanterie, une fausse fin avant la fin véritable.
Joseph Haydn avait l’habitude de tenir le premier violon lors de l’interprétation de ses quatuors, comme le rapporte dans ses souvenirs en 1784 le compositeur italien Giovanni Paisiello, venu à Vienne pour l’un de ses opéras; l’alto était alors joué par Wolfgang Amadeus Mozart, qui confia au sujet de son mentor, de vingt-quatre ans son aîné : « Lui seul a le secret de me faire sourire, de me toucher au plus profond de mon âme … » Gageons que ces quatuors, où le complexe s’allie à l’humour, le savant au populaire, sauront toucher leurs auditeurs.
Bénédicte Gandois
Bibliographie
Vignal, Marc, « Haydn », in François-René Tranchefort, Guide de la musique de chambre, Fayard, Paris, 1989.
Gonin, Frédéric, Quatre regards sur les quatuors de Joseph Haydn, Delatour-France, Sampzon, 2012.
Barbaud, Pierre, Haydn, Seuil, coll. Solfèges, 1963.
Robbins Landon, H. C., Haydn, Chêne/ Hachette, Paris, 1981.
QUATUOR TERPSYCORDES
Le Quatuor Terpsycordes redéfinit le lien entre un ensemble musical et son public. Il invente de nouvelles manières d’écouter un concert de musique de chambre et s’engage autant auprès des publics empêchés que des jeunes, pour transmettre son art au plusgrand nombre.
Le Quatuor Terpsycordes est l’histoire d’une amitié qui perdure depuis plus de 25 ans. Formé à Genève en 1997, guidé par la vision artistique de GáborTakács-Nagy et nourri par l’enseignement des membres des quatuors Amadeus, Budapest, Hagen, Lasalle et Mosaïques, le Quatuor Terpsycordes conquiert rapidement la scène musicale en remportant notamment le Premier Prixdu Concours de Genève en 2001. La rencontre avec des compositeurs majeurs du 20e siècle (György Kurtág, Sofia Goubaïdoulina), de même qu’avec des personnalités du monde baroque (Gabriel Garrido, Chiara Banchini, Florence Malgoire, Leonardo García Alarcón) contribue à définir et affiner l’évolution esthétique du Quatuor. Ses membres continuent aujourd’hui de collaborer régulièrement avec des partenaires de différents horizons, en intégrant des ensembles tels que l’Orchestre de Chambre de Genève, la Cappella Mediterranea, GliAngeli Genève, Contrechamps, l’Armée des Romantiques ou Elyma. Ces expériences permettent au Quatuor Terpsycordes de porter un regard toujours nouveau sur son répertoire. La prise de liberté et de risque est au coeur de sa démarche, marquée par une constante recherche d’équilibre entre cohésion de groupe et expression individuelle, respect du texte et indépendance face à la partition.
Le répertoire du Quatuor Terpsycordes s’étend de la période préclassique à la création contemporaine. Depuis 2021, il poursuit une intégrale sur instruments d’époque des quatuors de Joseph Haydn au Musée d’art et d’histoire de Genève, tout en entretenant une relation privilégiée avec les compositeurs genevois du 20e siècle. La publication, au printemps 2024 chez Claves Records, d’un nouvel album entièrement consacré à l’oeuvre de Frank Martin vient enrichir une discographie acclamée par la critique, qui aborde autant Haydn que Piazzolla.
Le Quatuor Terpsycordes s’engage activement dans des projets sociaux et éducatifs : il offre des concerts en partenariat avec des fondations, des associations et des établissements d’accueil pour les personnes en situation de handicap, de précarité ou de détention. Il collabore également avec des élèves des écoles de la Ville de Genève. Il transcende les conventions en offrant des expériences uniques visant à partager sa passion : que ce soit à travers des concerts en plein air dans des lieux insolites, des balades musicales à vélo ou des répétitions publiques, il crée des opportunités originales pour faire découvrir la magie de la musique de chambre à de nombreux publics.
Le Quatuor Terpsycordes bénéficie du soutien de la Ville de Genève et de la République et canton de Genève.
Girolamo Bottiglieri - violon
Raya Raytcheva - violon
Caroline Cohen-Adad - alto
Florestan Darbellay - violoncelle
REVIEWS
"[..] La primera de ellas está dedicada a la segunda triada del magnífico Op. 33 de Haydn. Se da la extraña circunstancia de que el primer disco del Op. 33 (5, 2, 1) del Quatuor Terpsycordes se publicó en 2006. Más vale tarde que nunca: 19 años después, este cuarteto fundado en Ginebra remata la serie con los últimos 3 Cuartetos, siguiendo el orden de la edición de Artaria (5, 2, 1, 3, 6, 4). Llaman la atención el laconismo y la viveza con la que el Terpsycordes acomete el primer movimiento del n. 3 (apodado El pájaro, en esta versión queda claro por qué). Sobresalen también los primeros rondós que Haydn incorpora al género (ns. 3 y 6), adecuadamente feroces. No es imprescindible rescatar a su pareja de baile de 2006, funciona bien como disco aislado. [..]" - Daniel Pérez Navarro, Diciembre 2025
"[..] Ce répertoire est bien connu du Quatuor Terpsycordes, qui depuis 2021 poursuit une intégrale sur instruments d’époque des quatuors de Haydn au Musée d’art et d’histoire de Genève. C’est sur la centralité de l’Opus 33 que l’ensemble se penche pour cette sortie chez Claves, en mettant à l’honneur trois de ces six quatuors. Les Genevois·es font cela avec un brio, un ravissant cisèlement expressif de l’engrenage polyphonique, une légèreté et une transparence de la diction musicale très philologique, qui illumine ce répertoire avec un équilibre aérien remarquable." - Gianluigi Bocelli, décembre 2025
"Dès son 2e disque en 2006, le Quatuor Terpsycordes abordait l’«Opus 33» de Joseph Haydn avec une pertinence très affûtée pour le jeune ensemble d’alors. Dix-neuf ans plus tard, ils complètent ce monument du classicisme, marqué au sceau de la profondeur et de la légèreté. En 1781, Haydn est au sommet de son art, mais ne lâche rien de son humour. Les Terpsycordes y assument leur maturité en souriant. Car les Genevois ont lancé une intégrale au concert des 68 quatuors à cordes de l’inventif Autrichien. C’est devenu leur langue paternelle!" - Matthieu Chenal, décembre 2025
Return to the album | Read the booklet | Open online links | Composer(s): Joseph Haydn | Main Artist: Quatuor Terpsycordes